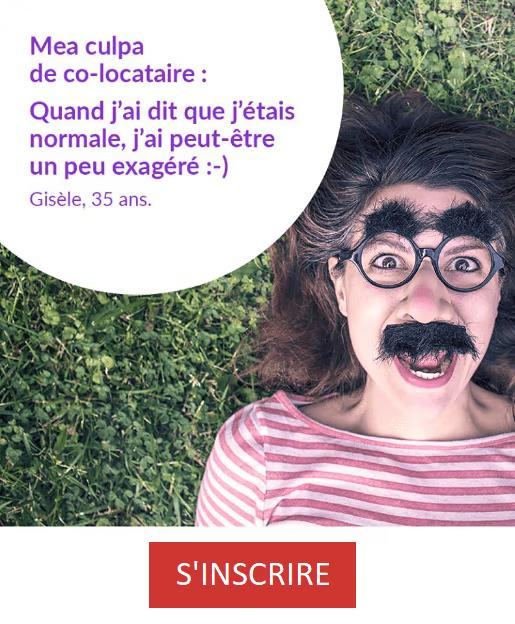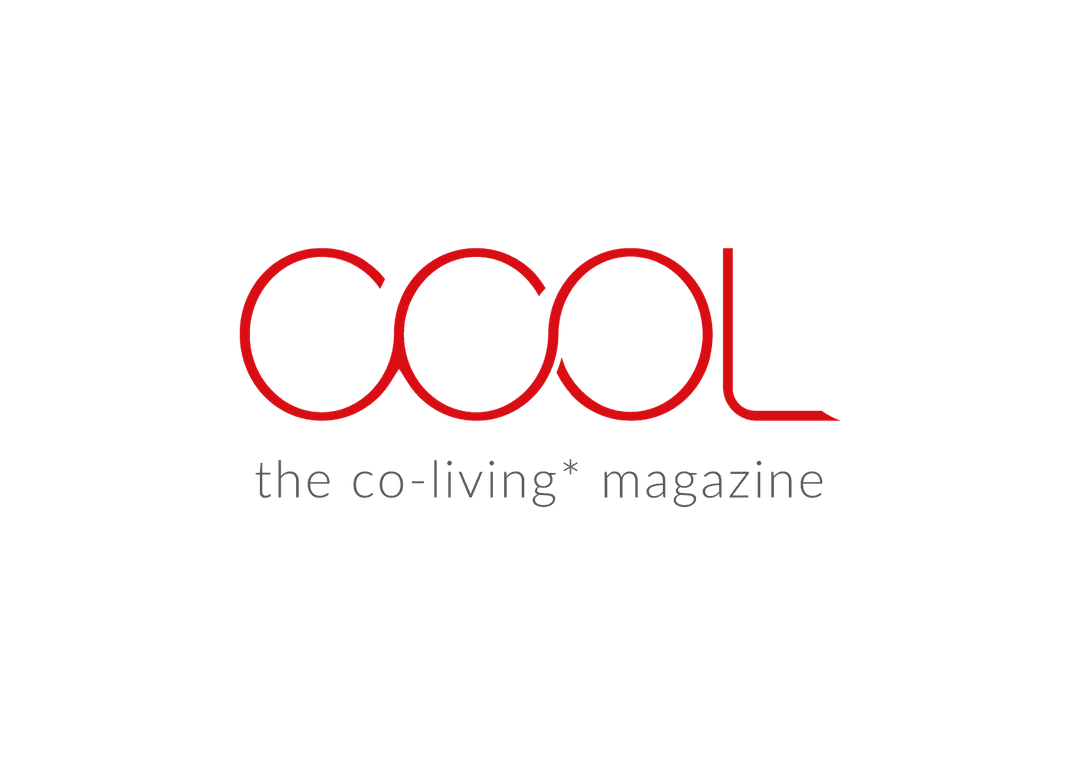

Transformer des bureaux en coliving : ce que change vraiment la loi Daubié
D'un côté, des plateaux entiers de bureaux qui se vident. De l'autre, une demande de logements qui explose. Transformer des plateaux de bureaux en logements semble être une solution évidente et toute trouvée. Pourtant, ce type de reconversion se heurte à un maquis réglementaire complexe et à des mairies récalcitrantes. La loi Daubié adoptée en juin 2025 entend changer la donne et simplifier les démarches. Mais les enjeux restent complexes. Entre nouvelles opportunités et résistances tenaces, décryptage de ce qui change vraiment avec cette nouvelle loi.
Post-Covid : quand les bureaux se vident
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en Île-de-France, plus de 5 millions de mètres carrés de bureaux restent vacants, soit un taux de vacance de près de 10% du parc tertiaire selon les dernières données de marché.
Avec la généralisation du travail hybride, les entreprises repensent leurs besoins d'espace, et privilégient des surfaces plus petites mais plus flexibles, délaissant les grands plateaux standardisés des années 2000.
Cette mutation ne concerne pas que Paris : Lyon, Marseille, Bordeaux et les autres métropoles françaises observent le même phénomène. Les propriétaires d'immeubles tertiaires voient leurs revenus locatifs baisser, alors que les coûts d'entretien et les taxes continuent de peser sur leurs budgets.
Pénurie de logements vs bureaux vacants : le paradoxe
Dans le même temps, la crise du logement s'aggrave. Les prix de l'immobilier résidentiel atteignent des sommets dans les grandes métropoles, rendant l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour les classes moyennes. La location n'échappe pas à cette flambée, avec des loyers qui progressent plus rapidement que les revenus.
Cette tension sur le marché résidentiel rend la tâche ardue aux locataires qui peinent à trouver des logements abordables dans les centres-villes. Face à cette pénurie, de nouveaux modes d'habitat émergent, comme le coliving.
Les bureaux offrent des surfaces importantes, souvent bien situées et desservies par les transports en commun. Leur transformation en logements, et notamment en coliving, pourrait répondre simultanément à deux problèmes : valoriser des actifs immobiliers délaissés et créer de l'offre résidentielle là où elle fait défaut.
Mais entre l'évidence économique et la réalité réglementaire, transformer des bureaux en coliving peut relever du casse-tête. C'est précisément ce verrou que la loi Daubié entend faire sauter.
Avant la loi Daubié : un parcours du combattant réglementaire
Transformer un bureau en logement relevait jusqu'en juin 2025 d'un véritable parcours d'obstacles administratifs. Entre terminologie complexe et procédures multiples, de nombreux propriétaires renonçaient avant même d'avoir commencé leurs démarches.
Le PLU, argument massue des communes pour refuser la transformation
La logique de zonage rigide héritée des années 1960-1970 constituait le principal obstacle à la reconversion. Chaque secteur urbain devait avoir une fonction précise et immuable, selon les Plans Locaux d'Urbanisme. Les quartiers d'affaires restaient dévolus aux activités tertiaires, les zones résidentielles à l'habitation, sans possibilité de passerelle.
Si une zone était classée “activités tertiaires” ou “bureaux” dans le document d'urbanisme communal, aucune dérogation n'était généralement accordée. Les communes brandissaient systématiquement leurs PLU comme argument d'autorité pour refuser les projets de reconversion, même les plus pertinents.
Ces refus quasi-automatiques décourageaient les investisseurs les plus motivés. Pourquoi engager des frais d'études et d'architecte si l'autorisation administrative avait si peu de chances d'aboutir ? Cette rigidité explique en partie pourquoi tant de bureaux restaient vacants malgré l'évidence économique de leur reconversion.
Les communes justifiaient cette intransigeance par la volonté de préserver l'équilibre fonctionnel de leurs territoires. Mais dans les faits, cette logique figée empêchait toute adaptation aux évolutions du marché et des besoins urbains.
Loi Daubié : 4 points qui changent la donne
La loi Daubié marque une rupture historique avec des décennies de planification urbaine rigide. Elle transforme les rapports entre propriétaires privés et collectivités locales. Pour Valérie Létard, la Ministre du Logement, “La transformation de bureaux vacants en logements n’est aujourd’hui plus un tabou, plus une utopie, c’est un levier concret pour résorber la crise du logement dans les grandes métropoles.”
Fini les refus automatiques : la charge de la preuve inversée
Désormais, les communes ne peuvent plus opposer un refus automatique en se contentant d'invoquer leur PLU. Elles doivent justifier leur opposition par l'un des quatre motifs limitatifs prévus par la loi.

Ces motifs sont volontairement restrictifs et doivent être étayés par des éléments objectifs. Une commune ne peut plus refuser une transformation sous prétexte que "ce n'est pas prévu dans le PLU" ou que "cela ne correspond pas à la vocation du quartier".
L'impact sur le rapport communes/propriétaires est considérable. Les communes passent d'une position de contrôle à une obligation de justification technique. Elles doivent désormais prouver que la transformation pose problème, plutôt que d'exiger du propriétaire qu'il démontre sa compatibilité avec l'urbanisme local.
Cette inversion change l'équilibre des pouvoirs locaux et provoque déjà des tensions entre l'État et les collectivités territoriales, qui y voient un affaiblissement de leur capacité de régulation urbaine.
Le permis à destination multiples : 20 ans pour changer d'avis
Cette nouvelle autorisation permet d'alterner entre usage tertiaire et résidentiel, sans nouvelle demande administrative, pendant 20 ans.
Concrètement, un propriétaire peut transformer ses bureaux en coliving pendant quelques années, puis revenir à l'usage bureau si le marché évolue, et ainsi de suite selon les opportunités économiques. Cette alternance bureau/logement sans nouvelle autorisation offre une flexibilité inédite aux investisseurs.
L'ancien système imposait un choix binaire et définitif : une fois la transformation réalisée, impossible de revenir en arrière sans engager une nouvelle procédure administrative complète. Cette rigidité constituait un frein psychologique majeur pour les investisseurs, qui craignaient de se retrouver bloqués avec des logements difficiles à louer dans certains secteurs.
Pour le coliving spécifiquement, cette souplesse est particulièrement précieuse car elle permet d'adapter l'usage aux évolutions de la demande locale et de tester le marché résidentiel sans risque définitif.
Copropriété facilitée et avantages fiscaux
Les règles de copropriété s'assouplissent également. Le changement d'usage vers l'habitation ne nécessite plus qu'une majorité simple en assemblée générale, au lieu de la majorité qualifiée précédemment requise (2/3 des voix). Cette simplification lève un obstacle dans les immeubles où les copropriétaires étaient réticents aux transformations.
L'exonération de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France constitue l'autre mesure phare. Les propriétaires de locaux vacants engagés dans une transformation bénéficient de cette exonération pendant 4 ans.
Ces incitations fiscales renforcées visent à accélérer les reconversions en rendant l'opération plus attractive financièrement, particulièrement en région parisienne où la taxe sur les bureaux peut représenter des sommes non négligeables.
Pourquoi le coliving s'adapte parfaitement aux anciens bureaux
Les plateaux tertiaires offrent de grandes surfaces modulables - souvent entre 200 et 500 m² - qui se prêtent parfaitement à la création de grands colivings.
De grands volumes
Les anciens open spaces deviennent naturellement de beaux espaces communs : cuisines ouvertes, salons spacieux, zones de coworking. De grands volumes, une hauteur sous plafond souvent supérieure à 2,50 mètres, de larges baies vitrées : les ingrédients sont là pour créer une sensation d'espace agréable.
Des infrastructures déjà en place
L'infrastructure technique des bureaux présente également des avantages : réseaux électriques et informatiques déjà dimensionnés, systèmes de ventilation performants, ascenseurs aux normes d'accessibilité. Pour les propriétaires, les coûts de transformation sont réduits par rapport à une reconversion classique.
De bons emplacements
La localisation constitue un atout majeur. Les bureaux sont généralement bien desservis par les transports en commun et situés dans des quartiers disposant de commerces et services. Cette accessibilité correspond parfaitement aux attentes des utilisateurs de coliving.
Résistances des mairies : les freins qui persistent
Malgré les facilitations apportées par la loi Daubié, les communes n'ont pas dit leur dernier mot. Privées de leur pouvoir de refus automatique, elles pourraient développer de nouvelles stratégies pour maintenir un contrôle sur les transformations de bureaux, particulièrement quand il s'agit de coliving.
Pourquoi les maires restent méfiants ?
La peur de la perte d'activité économique demeure l'argument principal des élus locaux. Cette inquiétude se traduit par plusieurs préoccupations concrètes :
- perte d'attractivité pour les entreprises qui cherchent à s'implanter ;
- diminution des recettes fiscales liées à la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) et à la taxe sur les bureaux ;
- déclin du commerce local qui vit de la clientèle des salariés.
Les contraintes d'équipements publics
L'arrivée de nouveaux résidents génère des besoins en services publics que les communes ne sont pas toujours en mesure de satisfaire immédiatement. L'insuffisance des transports en commun aux heures de pointe résidentielle - différentes des heures de bureau - peut également poser problème.
Si la transformation des bureaux en logements attire des familles avec enfants, les écoles du secteur peuvent rapidement se retrouver saturées. C'est d'ailleurs l'un des quatre motifs limitatifs prévus par la loi Daubié.
Coliving : nouvel épouvantail des élus ?
La méconnaissance du concept de coliving alimente de nombreuses craintes chez les élus locaux. Beaucoup assimilent encore cette forme d'habitat à des “dortoirs” précaires pour étudiants ou à des pratiques de sur-occupation des logements. Cette vision négative s'explique par l'absence de définition juridique claire et par quelques exemples médiatisés d'opérateurs peu scrupuleux.
Les élus peinent souvent à distinguer le coliving de qualité, solution de logement et créateur de lien social, des montages financiers destinés uniquement à maximiser les profits et la rentabilité.
Certains maires craignent que le coliving ne serve de paravent à des locations touristiques déguisées, échappant aux réglementations sur les meublés de tourisme et aux taxes afférentes.
Cette méconnaissance conduit parfois à des réactions disproportionnées, les élus préférant interdire par principe, plutôt que d'encadrer intelligemment ces nouveaux usages.
En facilitant la reconversion des bureaux vacants en logements, la loi Daubié répond à un besoin économique et social évident. Pour le coliving, cette réforme ouvre de nouvelles perspectives en levant plusieurs verrous administratifs.
Ce qu’il faut retenir de la nouvelle loi Daubié
- Inversion des rapports de force : fini les refus automatiques des communes basés sur les PLU. Elles doivent désormais justifier leur opposition par l'un des 4 motifs limitatifs : nuisances, accessibilité, saturation scolaire ou mixité sociale.
- Flexibilité de la destination pendant 20 ans : le permis à destinations multiples permet d'alterner entre usage bureau et logement pendant deux décennies sans nouvelle autorisation.